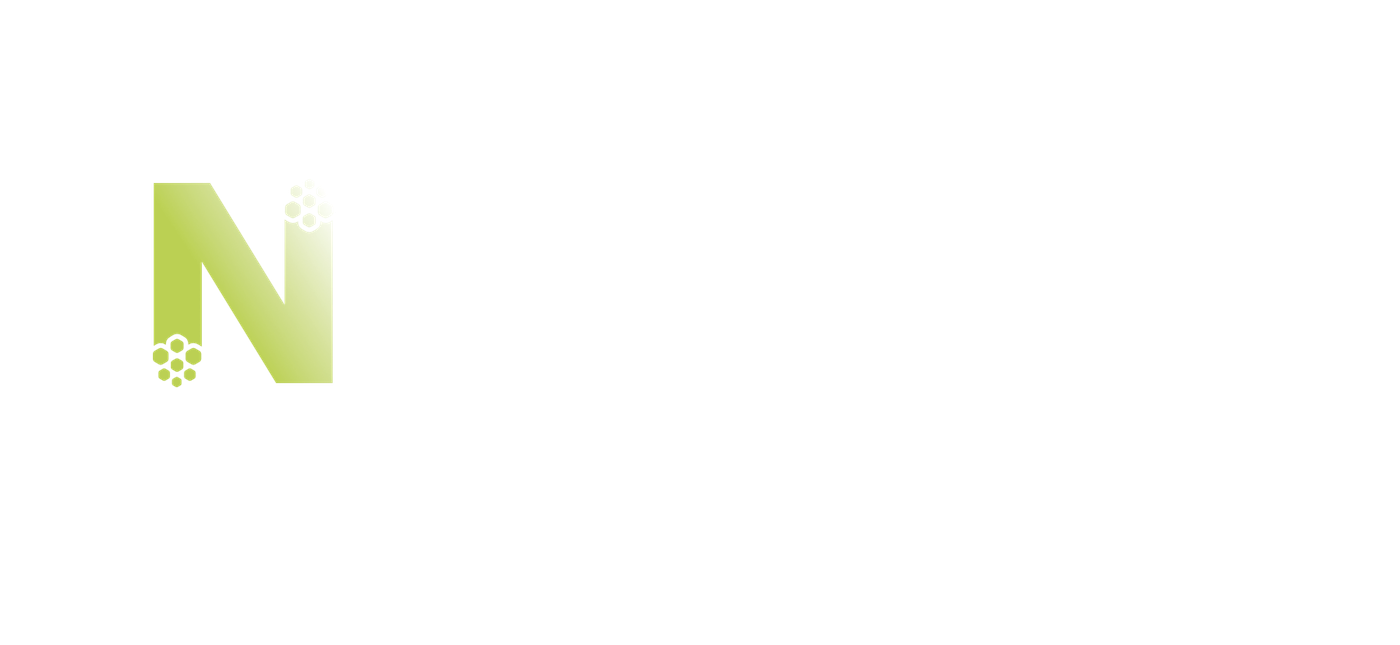Les végétaux incapables de fixer l’azote atmosphérique?
Ce n’est que très récemment dans l’histoire de l’humanité que nous avons compris le rôle prépondérant de l’azote dans la croissance des plantes. En 1848, le chimiste allemand Justus Von Liebig découvre que l’azote sous sa forme minérale est essentiel à l’alimentation des végétaux.
L’azote constitue 79% de l’atmosphère terrestre, il est indispensable à la synthèse de protéines pour le métabolisme des êtres vivants. Cependant, aucune plante identifiée à ce jour n’est capable d'assimiler l'azote de l'air directement et sans intermédiaire. Quelles sont donc les stratégies adoptées par les plantes pour assimiler l'azote?
L’azote minéralisé du sol: la première source d'azote pour les plantes
Une première source d’azote provient de la minéralisation des déjections animales et des résidus végétaux. Cependant, ce processus ne se fait pas seul. Les acteurs de cette transformation sont des micro-organismes du sol, capables de restituer dans leur environnement l’azote présent dans les protéines des résidus organiques. Pour faire simple, ces microorganismes se nourrissent et décomposent les résidus organiques du sol, comme les restes de végétaux post-récolte ou les déjections animales, et libèrent ainsi l’azote contenu dans ces déchets sous une forme assimilable par les plantes. C’est seulement après ce processus de décomposition que les plantes pourront se nourrir.
Dans certains cas, ce processus de minéralisation des résidus en azote assimilable est très lent, parfois inexistant. Ce phénomène peut être expliqué par différentes raisons. Cela peut être dû aux conditions climatiques arides ou froides qui ne permettent pas aux microorganismes d'être suffisamment actifs. Cela peut aussi parfois venir de la compétition entre plantes qui diminue le stock d'azote du sol. Dans ces circonstances de carence en azote, certaines plantes ont réussi à développer une stratégie étonnante de collaboration avec d'autres types de microorganismes pour survivre.

Pisum sativum, le pois est une plante légumineuse capable de capter indirectement l'azote de l'atmosphère grâce à sa symbiose avec les rhizobium
Les fabacées collaborent avec des microorganismes fixateurs d’azote atmosphérique:
Certaines plantes ont trouvé une solution étonnante pour ne pas être dépendantes de la disponibilité de l'azote dans le sol. Elles ont développé une collaboration avec des microorganismes qui possèdent un outil métabolique leur permettant de capter l’azote atmosphérique directement.
Ces végétaux font partie, pour l’essentiel, de la famille des fabacées (légumineuses) comme le pois, le haricot, le trèfle, la luzerne, mais aussi l’acacia, le mimosa, etc. Toutes ces plantes sont parvenues au fil de l’évolution à créer une symbiose totale avec une famille de bactérie spécifique, les rhizobiums. Ces bactéries ont développé lors de l'évolution une sorte de machinerie étonnante qui transforme l'azote atmosphérique (N2) en azote minéral.
Ces bactéries ne sont pas naturellement présentes dans les tissus des fabacées, elles sont présentes dans le sol et s’associent progressivement aux racines lors des premières phases de croissance de la plante. Elles sont ainsi hébergées par la plante hôte dans de petites vésicules racinaires, appelées nodosités. Ces nodosités permettent de constituer un environnement propice à l’activité de fixation de l'azote par les rhizobiums. Les fabacées fournissent donc gîte et couverts au rhizobium, et bénéficient en retour de l’azote capté par ces bactéries. C'est ce qu'on appelle une relation de symbiose (gagnant/gagnant).
La quantité d’azote fixée ainsi peut être très importante selon les espèces de fabacées. Par exemple, la luzerne peut capter jusqu’à 150 Kg de N (azote) par hectare et par an grâce à cette symbiose. Dans certaines conditions, la symbiose peut conduire à une fixation de 600 Kg d'azote/ha/an. Cette quantité d’azote fixée est cependant très variable et dépend fortement des conditions environnementales et des souches de rhizobiums. En présence d’azote minéral dans le sol par exemple, la plante n’a pas intérêt à concevoir des nodosités, car elle peut disposer facilement de la ressource directement dans le sol.
Cette symbiose est le fruit de l’évolution qui a permis de concevoir un système optimisé permettant de capter l’azote atmosphérique à moindre coût. Quant au procédé industriel Haber-Bosh inventé par l’homme à l’aube du siècle dernier, il permet de produire des engrais azotés, mais dans des conditions de températures et pression telles, qu’il est l’un des procédés les plus polluants de la planète. Responsable de 2,8 % des émissions de CO2 dans le monde chaque année, il consomme du gaz naturel issu de l’industrie pétrolière et énormément d’énergie.
Malgré le rôle majeur du procédé Haber-Bosh dans la révolution agricole du XXe siècle, il faut reconnaitre que l'efficience du procédé symbiotique est bien plus importante.